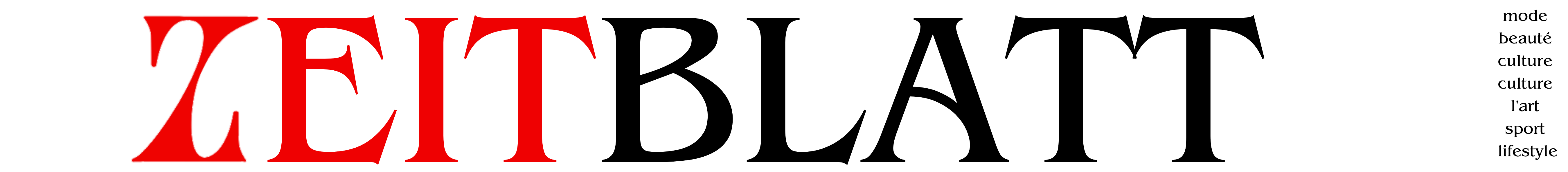EXPOSITION „FASHION BIG BANG“ PALAIS GALLIERIA DE PARIS : Naissance d’une mode décomplexée
Le Palais Galleria de Paris rend hommage à la mode de 1997 avec l’exposition „Fashion Big Bang“. Une année emblématique et exceptionnelle pour le monde de la mode, avec des défilés extravagants et les débuts de designers devenant ensuite le manifeste de toute une génération. En plus d’établir l’entrée dans le nouveau siècle,1997 fut l’année des langages et des expérimentations si pionnières que tous les codes établis de la mode ont été bousculés. Par Milena Soci
L’exposition 1997 Fashion Big Bang, qui tire son nom de l’expression que Vogue Paris utilisait pour distinguer cette période dite Big Bang, invite les téléspectateurs à découvrir ou à revivre la surprenante simultanéité d’événements charnières, avec la volonté de restaurer l’énergie créatrice d’une époque. Aujourd’hui, le système a profondément changé (féminisme, inclusivité, écologique, appropriation culturelle et mondialisation), tout cela exacerbé par la pandémie de Covid et les réseaux sociaux. Cette année 1997, a rétabli la prééminence de Paris en tant que capitale de la mode et a inauguré de nouveaux codes toujours présents sur les podiums mondiaux aujourd’hui.


Photos : Palais Galliera/DR
Organisée par Alexandre Samson, responsable des collections du Palais Galliera, l’exposition répertorie les collections marquantes, les défilés, les rendez-vous de créateurs, les ouvertures de magasins et les événements mondiaux qui ont eu lieu au cours de cette année singulière et qui ont eu un impact durable sur notre paysage de la mode contemporaine.
Dans une scénographie en U fourrée d’antichambres thématiques, le défilé est organisé chronologiquement, en commençant par le prêt-à-porter Printemps Été 1997, suivi des défilés Haute Couture Printemps Été 1997, haute-couture Automne Hiver 1997-1998 et Prêt-à-porter Printemps/Été 1998. Cette chronologie saisonnière est complétée par des événements historiques importants tels que l’ouverture du concept store parisien Colette et les décès de Gianni Versace et de la princesse Diana, contextualisant l’état liminal de l’industrie lourde de perturbations bien au-delà de la piste.
Changement d’attitude
L’exposition s’ouvre sur la collection de prêt-à-porter printemps/été 1997 de Gucci placée sous la direction artistique de Tom Ford, présentée à Milan en octobre 1996. En particulier, la première pièce d’archive exposée est le string dit G-string, emblématique précisément parce qu’il nous montre l’hédonisme et la vision décomplexée du créateur et pose les bases de la culture „porno chic“ qui s’imposera surtout outre-atlantique.



Photos : Palais Galliera/DR
Exactement quelques jours plus tard, les 7 et 8 octobre 1996, Martin Margiela et Rei Kawakubo présentaient leurs collections à Paris, respectivement sous le nom de „Stockman“ (Martin Margiela) et „Meets Body“ (Comme des Garçons). Les deux créateurs se partagent la critique : en effet, Martin Margiela décrit les formes classiques et présente des robes presque sommaires, avec des coutures apparentes et des matières brutes, tandis que Rei Kawakubo place des saillies sous ses vêtements, redimensionnant les figures du corps pour remettre en cause les canons de la perfection esthétique jusqu’alors pris en compte, notamment après l’avènement de chirurgie esthétique. C’est précisément la semaine de la haute couture printemps/été 1997 qui marque le début d’une période de rupture et déclenche la plus grande réaction médiatique du XXe siècle. En plus d’être l’année des créations explosives, 1997 a également marqué l’année de l’invasion britannique du monde de la mode française avec des créateurs britanniques prenant la direction artistique des maisons de couture françaises avec Alexander McQueen chez Givenchy et John Galliano prenant les rênes de Dior. Une période de métamorphoses et d’extravagances qui conduit les marques à prendre des chemins imaginatifs diamétralement opposés.
Deux trublions anglais chez les grandes marques françaises
Jean-Paul Gaultier, par exemple, après avoir refusé la direction artistique de Givenchy et de Christian Dior, inaugure son entrée dans la haute couture. Son premier recueil, daté du 19 janvier 1997, surprend les critiques pour son classicisme et la recherche exaspérée de la pureté esthétique. À partir de ce moment, le créateur français va entrer officiellement dans l’Olympe de la haute couture française, et ce, jusqu’en 2020, sa dernière collection officielle.


Photos : Palais Galliera/DR
À l’inverse, la collection de John Galliano pour Christian Dior exalte l’exagération baroque du passé. Glitz, plumes, formes extrêmes, toutes les caractéristiques du fondateur et prédécesseur de la Maison parisienne, ainsi que des références à l’iconique tailleur Bar de 1947. Alexander McQueen est âgé de seulement 27 ans lorsqu’il se voit confier la direction artistique de Givenchy. Créateur en vogue et reconnu par ses pairs et surtout le plus suivi de sa génération, ses premiers travaux chez Givenchy font l’objet de critiques amères par la presse, car il est accusé de s’éloigner de la haute couture en créant des costumes. En fait, la collection, inspirée des mythes de la Grèce antique, a exploré les couleurs royales et a été exécutée en or et blanc, une palette tirée d’une marque Givenchy, et comportait une couture stricte pour les femmes. Il entra toutefois dans la haute couture de l’époque comme „un éléphant dans la verrerie“. L’exposition se poursuit avec la collection printemps/été „Insectes“ créée par Thierry Mugler et présenté le 22 janvier 1997. Les vêtements, comme le suggère le titre, s’inspirent des insectes et du cinéma, notamment des films Microcosmos (1996) de Claude Nuridsany et Marie Pérennou et L’Insecte (1968) de Jacques Brosse.
„J’ai toujours été fasciné par les insectes, leur carapace, leur graphisme futuriste. Ils ont une fragilité et une légèreté juste recouvertes d’une enveloppe de protection, à l’image de la femme que j’habille“ précise le créateur.
L’avènement d’une nouvelle vague
1997, c’est aussi l’année de Raf Simons, qui fait ses débuts à la fashionweek de Paris avec sa collection printemps/été „Black Palm“, Christian Lacroix et sa jubilation des contraires (Élément baroque à la fois moderne et linéaire), Gianni Versace, et sa dernière collection (avant son assassinat à Miami) présentée à Milan et bien sûr Jeremy Scott et sa collection prêt-à-porter printemps/été 1998 „Rich White Woman“.


Photos : Palais Galliera/DR
L’exposition se poursuit, mettant en lumière quelques moments fondamentaux historiques de la mode, comme le début de la direction artistique de Donatella Versase immédiatement après la mort de son frère Gianni, ou la première œuvre de Nicolas Ghesquière pour Balenciaga, qui changera à jamais l’imaginaire de la marque espagnole et en jettera les bases d’une vision ultramoderne et futuriste toujours présente actuellement.
Enfin, sauter quelques étapes pour ne pas complètement enlever la curiosité et l’envie d’aller voir cette exposition, le parcours se termine par un hommage au photographe de mode Davide Sorrenti (Décédé, il y a à peine vingt ans à cause d’une thalassémie (maladie génétique rare), membre de la fameuse „tendance héroïne chic“, présentée à titre posthume en couverture du New York Times. En plus de visualiser cette vague de changement institutionnel, l’exposition reconnaît également une coalescence de la musique, du film et de la photographie d’art autour de la mode, cette dernière étant encore mal vue à cette époque.
L’exposition est temporaire et ouverte au public du 7 mars au 16 juillet 2023, et les prix des billets varient de 15 (plein tarif) à 13 euros (tarif réduit), gratuit pour les moins de 18 ans
Photos : Palais Galliera/DR